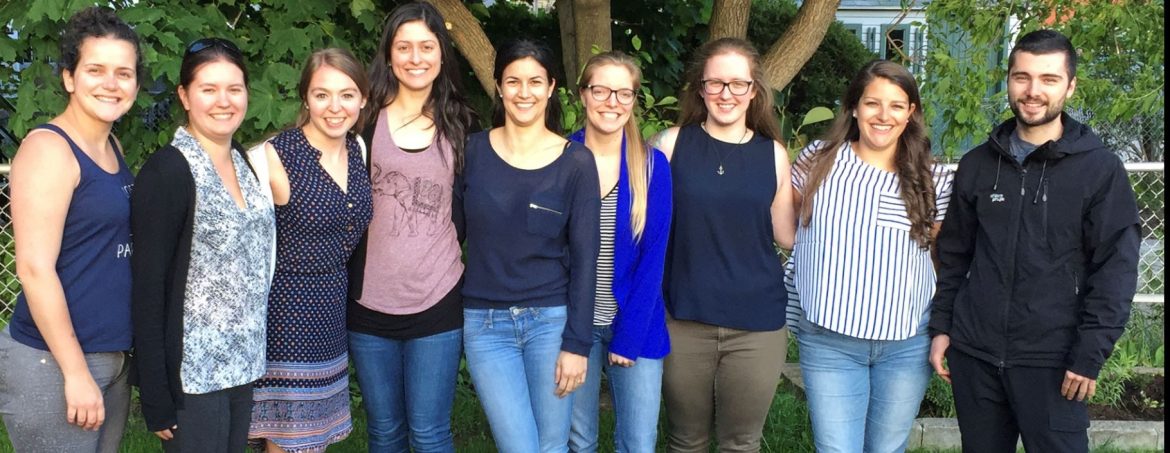Le 1er juillet marque la fin des études de plusieurs résidents en médecine qui vont dans les prochains jours débuter leur pratique officielle. C’est là où le long chemin universitaire s’achève. C’est le moment où l’on s’arrête un instant, pour célébrer, avant la prochaine ascension. C’est la fébrilité avant le grand départ. Une longue aventure, riche de liberté, de défis et de responsabilités commence. Chers résidents désormais patrons, je voulais vous féliciter pour votre graduation, pour ce dur labeur enfin reconnu. Je n’ai pas d’études scientifiques à vous citer aujourd’hui. Malheureusement ou heureusement, les données probantes ont leur limite. J’ai quand même pensé vous laisser quelques petits apprentissages que j’ai grappillés ici et là, dans mon propre parcours, si cela pourrait vous éviter des détours.
- Être à l’écoute des inquiétudes de vos collègues : on nous enseigne de demander aux patients s’il y a des inquiétudes liées à leur raison de consultation… aujourd’hui, je vous suggère de toujours vérifier et prendre au sérieux les inquiétudes des collègues qui vous entourent. Que ce soit l’infirmière au triage, celle en réanimation, le médecin qui vous appelle de son bureau pour un patient qui ne va pas bien… prenez toujours la demande avec attention et diligence (même si cela veut souvent dire plus de travail pour vous). Personne n’aime « déranger » quelqu’un d’autre pour le plaisir. Lorsqu’on prend le temps de venir discuter d’un cas avec un collègue, c’est généralement qu’on y a pensé deux fois… cela s’applique aussi à vos confrères spécialistes pour les appels que vous leur faites de nuit : lorsqu’on décide enfin de prendre le téléphone, c’est qu’on a vraiment besoin d’eux. Je sais… il y a des gens qui s’inquiètent plus facilement que d’autres. Néanmoins, j’ai appris que si quelqu’un me demande de voir rapidement un patient qui semble ne pas bien aller, mieux vaut acquiescer tout de suite et vérifier l’inquiétude du collègue, plutôt que de minimiser ou remettre à plus tard. Répondez rapidement aux angoisses de vos pairs et membres de votre équipe : ils vous aideront la plupart du temps à mieux prioriser les patients : c’est un de vos meilleurs filets de sécurité pour ne pas échapper de cas.
- « Une deuxième visite est une deuxième chance de faire le bon diagnostic » : lorsqu’un patient consulte de nouveau pour le même problème, on peut parfois ressentir une certaine lassitude, un sentiment de contrariété… « il vient de venir pour cela ! » On peut avoir envie de régler cela au plus vite. Il est vrai que beaucoup de patients reviennent parce qu’ils demandent à être rassurés, que la durée normale de la maladie ne leur a pas été bien expliquée (ex : la plupart des lombalgies ne demandent pas d’imagerie avant 6-8 semaines, un urticaire viral chez l’enfant peut durer deux semaines, etc…) Néanmoins, il se peut aussi qu’il s’agisse d’un cas plus rare, d’une évolution défavorable, d’une complication… ainsi, mieux vaut reprendre depuis le début, se réserver un peu plus de temps pour une deuxième visite, rouvrir le diagnostic différentiel. C’est une seconde chance, de faire encore mieux !
- Les antécédents médicaux du patient comptent : tôt dans mon début de pratique, j’étais tenté de maximiser mon débit en minimisant la revue des dossiers antérieurs. C’était de l’inexpérience. Le petit « 5 minutes » passé à réviser les antécédents du patient peut tout changer. Nous sommes habitués à considérer l’histoire de MCAS ou d’embolie pulmonaire pour le patient avec douleur thoracique, ou un épisode ancien d’urolithiase pour les patients avec douleur au flanc. Cependant, pour certains diagnostics graves ou rares, un ATCD pertinent peut tout changer. Le patient avec douleur cervicale subite qui a été hospitalisé il y a quelques mois pour une discite commande un niveau de suspicion plus élevé. De la même façon, un ATCD d’AAA chez un patient avec douleur au flanc augmentera rapidement votre niveau d’anxiété. Après avoir lu votre raison de consultation, prenez un instant pour réviser tous les antécédents du patient, à la recherche d’un élément qui pourrait influencer la prise en charge. En médecine, le passé est souvent garant du futur.
- La tendance des signes vitaux compte… deux ou trois fois par quart de travail, regardez rapidement vos télémétries et moniteurs pour voir la tendance… un court survol suffit souvent. Une tachycardie qui progresse mérite qu’on réévalue le patient. La tachycardie est souvent présente pour les patients qui évoluent vers le choc.
- Le meilleur moyen de manquer un diagnostic est d’en poser un autre : que ce soit chez le patient avec une fracture ouverte de la cheville qui détourne de la fracture cervicale, chez le STEMI inférieur avec bloc du 3e qui passe inaperçu ou chez le patient avec symptômes d’AVC où la dissection aortique n’est pas recherchée, on a tendance à jeter notre dévolu sur le diagnostic évident. Lorsque vous inscrivez vos impressions sur votre note, assurez de prendre un peu de recul, l’espace d’un instant, pour revoir le tableau dans son ensemble, pour s’assurer que rien ne soit passé sous le radar.
- Exposez vos « zones grises » ou vos incertitudes au patient : en médecine, rien n’est 100%. J’essaie de ne jamais dire au patient « que tout est normal », ou « que vous n’avez rien »… Je peux dire que « je n’ai rien trouvé de grave aux bilans »… « que je suis rassuré par rapport à tel ou tel diagnostic »… j’essaie aussi de dire au patient les symptômes d’alarme qui méritent une nouvelle consultation. Lorsque j’hésite entre deux conduites, comme lors d’une procédure invasive comme une PL ou un cathétérisme urinaire, j’implique le patient dans la décision finale, en essayant d’expliquer les avantages et les inconvénients de la démarche diagnostique. Cela m’a beaucoup aidé à diminuer ma propre anxiété, et souvent celle du patient.
- Le non-verbal du patient compte : en fin d’entrevue, vérifier si le patient a des questions, des incompréhensions… soyez alors attentif au non-verbal. Si vous avez l’impression qu’il y a du « non-dit » ou une insatisfaction qui transparaît, questionnez tout de suite le patient à cet effet. Cela pourrait vous permettre d’adresser des inquiétudes ou de prévenir une visite subséquente.
- Faites le suivi de vos cas particuliers : il arrive parfois qu’on hospitalise un patient pour un diagnostic à préciser ou qu’on transfère un patient à un collègue à la fin de notre quart, dans l’incertitude. Je vous encourage à faire sortir les dossiers des patients chez qui le diagnostic n’était pas clair, afin de toujours raffiner vos vignettes-cliniques. Gardez ces numéros de dossier en réserve quelque part et faites les sortir a posteriori quelques fois par année, pour connaître la suite. Les patients que l’on rencontre et la façon dont ils évoluent sont bien meilleurs que les livres de référence pour nous enseigner l’essence d’une maladie.
- Tirer une « perle » des cas qui nous ont marqués : si vous faites de la médecine assez longtemps, vous accumulerez des cas « moins roses », des patients qui n’ont pas évolué selon les attentes, de possibles manquements… je suis souvent habité par ces cas, je les pense et les repense… avec un souvenir amer… un sentiment d’échec. Si un jour vous prenez conscience que vous ressassez trop souvent un même cas dans votre esprit, mieux vaut prendre le temps de faire un journal réflexif, d’écrire en détails l’histoire de cette rencontre. Et à la fin, tenter de dégager un apprentissage de cet événement moins heureux : « la prochaine fois, voilà ce que je ferai, si un cas similaire se présente ». L’objectif est de sortir du cercle de la culpabilité, et de se mettre en mode « constructif». Il faut tenter de voir dans ces difficultés les opportunités d’apprentissage qui font de nous de meilleurs cliniciens avec le temps.
- Comme l’a dit il y a quelques années le Dr Charles Scriver à ma graduation, il ne faut jamais oublier l’essence même de notre travail, la raison pour laquelle on se lève le matin : « qui vais-je servir aujourd’hui ? »
Même si les études sont terminées, vos connaissances vont grandir et s’affiner, les plus importantes vont se bonifier. L’expérience est la meilleure des écoles. On ne finit jamais d’apprendre … je lève aujourd’hui mon verre à vous, et à ce long processus qui ne fait que commencer. À une carrière fructueuse et riche de sens !
Frédéric Picotte, MD
Urgence de Shawinigan
NB : en photo, félicitations à nos résidents finissants du CUMF de Shawinigan!